Los sufixes diminutius e augmentatius
Docx : 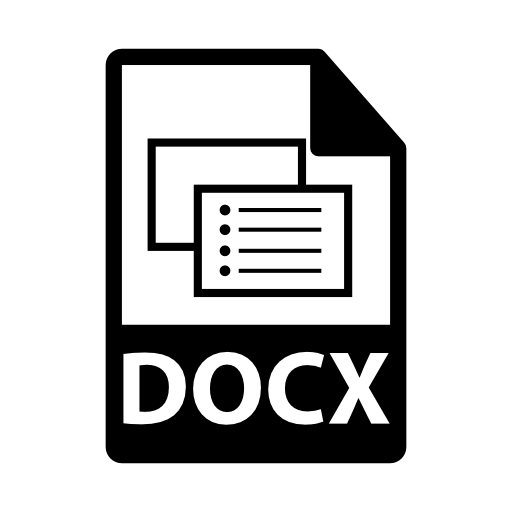 Los sufixes (7.05 Ko)
Los sufixes (7.05 Ko)
Ils sont très employés.
1. - Les suffixes diminutifs les plus courants sont :
-et -eta, -òt/-òta, -in/-ina et -on/-ona.
Les deux premiers peuvent avoir :
— une simple valeur diminutive.
Ex. : ua maisoeta (une petite maison).
— une valeur diminutive avec une connotation péjorative ou une nuance de commisération.
Ex. : lo praubòt, n'es pas guaire intelligent (le pauvre petit, il n'est guère intelligent).
— une valeur diminutive avec une connotation de sympathie nuancée parfois de compassion.
Ex. : qu'avè hami, lo praubet (il avait faim, le pauvre petit).
Les deux derniers ont la plupart du temps une nuance de tendresse et d’affection.
Ex. : praubin (pauvre petit) ; berogin (petit mignon) ; petiton (tout petit) ; veteron (petit veau).
Ces suffixes peuvent s'ajouter aux adjectifs, aux noms communs, aux noms propres et prénoms, voire aux adverbes.
Ex. : un ostalin (une petite maison) ; joanòt (petit Jean) ; soventòtas (assez souvent).
2. - L'augmentatif le plus courant est -ès, -assa. Les mots ainsi formés sent presque toujours très péjoratifs, exprimant une nuance de lourdeur, de maladresse.
Ex. : ua hemnassa (une grosse/vilaine femme) ; un canhàs (un grand chien).
On trouve aussi -assèr, -assèra, ou -anèr, -anèra exprimant l'exagération dans une mauvaise habitude.
Ex. : cridassèr (braillard) ; pintassèr (ivrogne) ; hartanèr (ivrogne, noceur)
On trouve enfin parfois les augmentatifs -arro, -arra ; -erro, -erra ou -orro, -orra.
Ex. : un gatarro (un gros chat) ; un canharro (un gros chien).
3. - Plusieurs de ces suffixes peuvent s'associer pour former des surdiminutifs.
• -òt + -et ou -òt + -òt.
Ex. : can->, canhotet/canhotòt (très petit chien).
• -òu/-òl + -et ou -òu/-òl/ + -òt.
Ex. : gat->, gatolet (très petit chat) ; cap->, cabolet/cabolòt (très petite tête)
• -òt + -et ou -òt + -on.
Ex. : Pèir->, Peirotet/Peiroton (petit Pierre).
• -on + -et.
Ex. : petit->, petitonet (très petit).
— des diminutifs-augmentatifs.
• -on + -às.
Ex. : gat->, gatonàs (vilain petit chat).